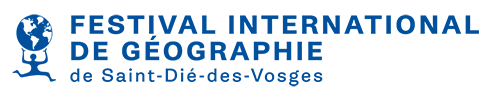Ce vendredi 3 octobre, à l’Espace Georges-Sadoul, des géographes ainsi que la climatologue Valérie Masson-Delmotte, présidente du FIG 2025, ont partagé leurs réflexions sur la place des géographes face aux pouvoirs.
Les scientifiques doivent-ils désobéir ? Tel était le titre de la table ronde proposée dans la salle Yvan-Goll de l’Espace Georges-Sadoul en début d’après-midi. Une question qui interpelle. Pourtant, elle découle d’une réalité à laquelle les géographes doivent de plus en plus se confronter pour simplement exercer… leur métier.
« Le droit à la science est fondamental », a déclaré Valérie Masson-Delmotte en introduction. Experte du climat, elle s’emploie à alerter les pouvoirs publics sur l’évolution climatique. « Notre rôle oscille entre la co-construction des connaissances et celui de chien de garde du climat », a-t-elle expliqué un peu plus tard. Pour elle, si les géographes veulent se faire entendre, une solution s’impose : montrer l’exemple en transformant leurs habitudes quotidiennes (mobilités, alimentation, etc.).
« Les géographes sont pointés du doigt comme des scientifiques engagés dans ce qui ne sert à rien », a dénoncé David Goeury, géographe. « Comment faire de la science quand ce que l’on produit est considéré comme inutile ? », s’interroge Anne-Laure Amilhat Szary, également géographe. « Ceux qui annulent les autres ne sont pas ceux de la « cancel culture », mais des gens bien installés », poursuit-elle. Tous deux reconnaissent toutefois bénéficier d’une « liberté pédagogique protégée ».
Cette négligence, souvent liée à un contexte économique, entraîne de la désinformation, voire des interdictions, comme aux États-Unis où des météorologues sont empêchés de toute discussion avec leurs homologues étrangers. « Ce qu’on observe aux USA se retrouve aussi en Hongrie, voire en France, avec les attaques contre l’Office national de la biodiversité », affirme la présidente du FIG 2025.
Historiquement de très nombreux géographes ont travaillé à l’échelle locale par manque de moyens au début du XXe siècle. Cette approche méthodologique reste très importante aujourd’hui pour analyser de nombreux phénomènes sociaux. Or localement, les géographes s’exposent aussi à des pressions et à la remise en question de leur travail.
Ainsi, à Montpellier, le géographe Laurent Viala, a démontré dès les années 1990 que le projet de métropolisation porté par les élus accroissait les inégalités et créait des trappes de pauvreté dans les communes environnantes. Cependant, ce discours a été fortement contesté et marginalisé durant plus de deux décennies.
« Nous vivons dans un monde qui entretient la confusion », regrette Anne-Laure Amilhat Szary. « Il faut rétablir l’art de la conversation directe », propose de son côté David Goeury. Ce que la géographe approuve : « La question du dialogue est essentielle pour que l’engagement d’un géographe soit perçu positivement ». Le salut passera peut-être par là.