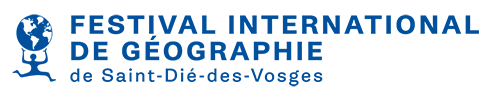Ce dimanche matin, Jacques Lévy s’est attaché à faire comprendre le vote en faveur de l’extrême droite en France. De façon un peu sociologique mais surtout géographique, bien sûr.
Un espace mini-conférences blindé, comme souvent durant ces trois jours ; une intervention d’une demi-heure sur le papier, trois quarts d’heure dans la réalité et qui aurait pu durer encore et encore vu l’engouement du public, s’il n’avait fallu libérer la place. Dimanche matin, aux premières heures du FIG, le géographe Jacques Lévy a conquis son auditoire dès ses premiers propos. Une analyse de la répartition spatiale des votes favorables à Kamala Harris et ceux favorables à Donald Trump a posé les bases de son exposé : la géographie des votes pour l’extrême droite en France.
Carte et cartogramme réalisés après le premier tour des législatives de 2024 à l’appui, le géographe commente les nuances de bleu répertoriées sur le territoire métropolitain. Sachant que plus on file vers le bleu nuit, plus le score de l’extrême droite est élevé. « Dans l’ensemble, on remarque une certaine homogénéité. »
Ouverture versus défiance
Arrive alors la notion de gradient d’urbanité, selon laquelle plus l’urbain est dense, plus il est propice à la diversité, à l’ouverture, à la tolérance. Plus l’urbanité est faible, plus on serait dans la défiance. Retour à la carte : le bleu est plus clair dans les métropoles et les grands centres, plus foncé dans les zones périurbaines. Pour faire simple : il y a plus de votes en faveur de l’extrême droite dans les campagnes que dans les villes. « Je n’explique rien, je me contente de constater », rappelle Jacques Lévy. En Figueurs avertis que vous êtes, vous pensez bien que le public la posera, cette question : pourquoi ?
C’est là où la sociologie prend le pas sur la géographie. Jacques Lévy tente plusieurs explications. La première d’entre elles étant que le gradient d’urbanité est le plus fort marqueur de clivage, selon une enquête Acadie Chrônos Ifop de décembre 2024. Davantage que la catégorie socioprofessionnelle, l’âge ou les revenus des électeurs. « Les partis politiques n’arrivent pas à capter l’essentiel des clivages des gens, sauf l’immigration. La France est un pays de défiance et il est clairement démontré que plus on s’éloigne du centre de Paris, par exemple, moins on a confiance. On l’a vu lors du mouvement des Gilets jaunes, très présent dans les zones périurbaines. » Le géographe affirme que dans ces aires, on apporte plus d’importance au capital économique qu’au capital culturel. Que l’on préfère investir (dans l’immobilier par exemple, même si l’on a des revenus limités) plutôt que susciter du flux et remettre en jeu sa position sociale en permanence. « Les votes défiants, c’est la réticence à s’engager dans ce type de processus. Devant la menace, c’est plus confortable de ne rien avoir à perdre. »
Syndrome post-traumatique industriel
Autre explication apportée après une question sur la faiblesse de la présence de l’extrême droite dans des régions comme la Bretagne : « Globalement, l’Ouest n’a pas eu d’industrie. Les régions qui ont connu l’industrie souffrent d’un syndrome post-traumatique et la thématique anti-immigration porte davantage lorsque le travail manque. »
La dernière question ouvrait des perspectives… Peut-on prévoir l’avenir du vote pour l’extrême droite en France s’il est guidé par le gradient d’urbanité ? « Voter est un acte individuel. Ce n’est pas le gradient qui détermine le vote, mais il y a une corrélation. S’il est improbable qu’il y ait moins de périurbain, on peut imaginer une modification en douceur du mode de vie dans les zones périurbaines avec une meilleure prise en compte des mobilités, par exemple, avec davantage d’activités et de services. » Clap de fin. Avec le sourire, Jacques Lévy propose de poursuivre l’échange autour d’un café. Parce qu’il y a encore beaucoup de choses à dire, à comprendre et à imaginer.