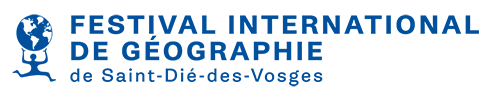Tout le monde connaît Wikipédia, la plus grande encyclopédie collaborative du monde. Pourtant si on a tous en tête l’aspect encyclopédie, le côté collaboratif peut parfois nous échapper. Mathilde Joncheray, géographe et maître de conférences à l’université de Toulouse, est intervenue ce vendredi après-midi pour aborder la question des inégalités sur la plateforme collaborative.
C’est dans une salle Isabelle Autissier complète que la géographe rappelle ce qu’est Wikipédia. En plus de l’espace de connaissance, c’est un terrain de discussion, que l’on retrouve dans les pages “bistro”, qui introduisent une discussion entre les contributeurs ou dans les pages projets, par exemple. Pourtant, malgré cet aspect populaire, le site se définit comme hors de toute expérience politique, démocratie incluse. Les quelques votes qui ont lieu font souvent office de sondage consultatif, sans réelle incidence sur le site. Bien que le site français compte 40 000 contributeurs uniques, seule une vingtaine de profils pèsent dans cette gigantesque oligarchie. Qui sont-ils ?
Principalement des contributeurs masculins et français
D’après différentes enquêtes, depuis 20 ans 80% des contributeurs de l’encyclopédie seraient des hommes. Les femmes sont sous-représentées et il peut être dur pour elles de trouver leur place dans cet univers masculin. L’inégalité se ressent dans le choix des sujets traités. Si l’on compare les contributeurs des pages de géographes hommes et femmes, on se rend compte que les contributeurs masculins traitent presque exclusivement leur genre, tandis que les femmes s’occupent davantage des deux, cette analyse se vérifie pour d’autres disciplines. Pour ce qui est du choix des sujets, les hommes sont plus égocentrés et traitent beaucoup de sujets masculins.
Les autres francophones sont aussi mis de côté. C’est la vision de l’Académie française qui prime. Le reste de la francophonie est alors écarté. A cela s’ajoutent des inégalités d’accès au numérique, et aux sources pour les Africains (alors qu’ils représentent une grande partie de la francophonie).
Malgré cette vision terne du fonctionnement de l’encyclopédie, la géographe a tenu à rappeler en conclusion que c’est aussi des collectifs, et de l’entraide pour beaucoup de personnes.