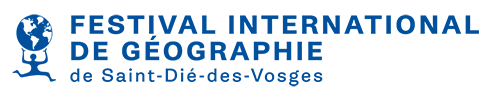La démocratie participative pour compenser l’intermittence de la représentativité ?
Participation citoyenne et représentativité : l’un sert-il à palier la défiance vis-à-vis de l’autre ? C’est l’une des questions posées par Sandrine Vaucelle et Christophe Léon, samedi soir au Darou
Carton plein pour le café-géo de samedi soir à la Cabane du Darou. Au premier étage de l’établissement si atypique de la rue de la Prairie, impossible de glisser un photographe filiforme entre deux spectateurs, marches de l’escalier blindées… même le tabouret des toilettes des hommes était squatté… « Objets » de toutes les attentions : Sandrine Vaucelle, géographe maître de conférences, et Christophe Léon, professeur de géographie, venus, au nom de l’Association des professeurs d’histoire et de géographie, discourir sur la démocratie participative et s’interroger sur le pouvoir d’agir des citoyens. Parce que, finalement, « on voit souvent le pouvoir d’en haut, jamais d’en bas » résumait en préambule Sandrine Vaucelle. Pourquoi une telle affluence au bar ? Probablement parce que « la démocratie participative n’est pas trop enseignée dans les IEP, même si une entrée en géographie est possible », affirmait Christophe Léon. La question qui a prévalu, évidemment, consistait à donner une définition à la démocratie participative. Et un sens, surtout. « La démocratie représentative est qualifiée d’intermittente parce que les citoyens ne s’expriment qu’entre deux suffrages, c’est-à-dire peu souvent », a expliqué la maîtresse de conférence. Est-ce un argument suffisant pour justifier un abstentionniste galopant ? « En tout cas, la démocratie participative permet de ne pas être actif que lors des élections, mais dans tout le processus de décision. »
Planche de salut
« Une solution à la défiance » qui ne plaît pas à tous, comme l’a expliqué Sandrine Vaucelle. « Certains élus trouvent le principe bancal et contraire au principe constitutionnel de représentativité. A l’inverse et pour les mêmes raisons, ceux qui y sont favorables ont tendance à souhaiter justement que l’on revoie la Constitution. » Et l’enseignante de s’interroger : « La démocratie participative est-elle la planche de salut locale pour revivifier la démocratie ? » Avec un bon dans l’histoire, elle rappelle cette charte qui octroie « le droit aux citoyens de participer », explicite les conventions citoyennes – post gilets jaunes, par exemple – ; revient sur la loi Barnier de 1995 relative à la participation du public et des associations en matière d’environnement. Un rappel qui l’amène, avec l’exemple des incinérateurs XXL de Nantes de ces derniers mois, à affirmer que, finalement, la participation citoyenne n’existe que lorsqu’il y a une contestation.
Au fil de ce café géo, le duo a décliné les différentes lois et textes pour parvenir à ceux qui sont au coeur de leur propos et répondent à la problématique abordée : les dispositifs de démocratie participative à l’échelle locale. Budgets participatifs, concertations publiques, votations, sont en plein essor. Quittant « l’éducation civique » abordée jusque-là, les deux géographes sont alors revenus sur l’aspect géographique de la démocratie participative, et notamment les enjeux et les nouveaux métiers qui y sont liés.