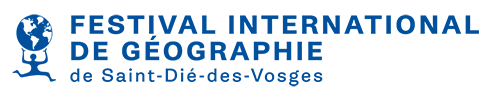Natif de Saint-Dié-des-Vosges, Jules Ferry reste l’un des grands noms de la Troisième République. En ce deuxième jour de festival, Christian Pierret, fondateur du FIG, Jean Pisani-Ferry et David Valence sont revenus sur ce personnage haut en couleur, lors d’une discussion animée par Vianney Huguenot.
Christian Pierret, ancien maire de Saint-Dié-des-Vosges et président-fondateur du Festival International de Géographie, rappelle que Jules Ferry était avant tout un député enraciné, profondément attaché à sa ville natale et à ses paysages. Quant à David Valence, conseiller régional, il le décrit comme « un nom familier qui incarne l’idéal républicain ». Mais son œuvre dépasse largement la seule politique scolaire ou coloniale.
Jean Pisani-Ferry, économiste, précise que l’école, pour Ferry, n’est pas qu’un projet civique : il s’agit de combler le retard français par rapport à la Prusse, de préparer la revanche militaire et de former une main-d’œuvre plus qualifiée pour renforcer l’industrie et la compétitivité du pays.
Contrairement aux idées reçues, Jules Ferry n’est pas un penseur du colonialisme. Il n’a jamais écrit sur le sujet, et la politique coloniale de son époque bénéficie d’un soutien limité, tant économique que populaire. Son approche relève plutôt d’une « politique de la fierté », c’est-à-dire réarmer moralement la nation pour qu’elle retrouve sa cohésion et sa grandeur. Patriotique avant tout, il veut redonner à la France sa puissance et sa fierté, avec un esprit impérialiste orienté vers la reconstruction morale plutôt que la conquête.
Ferry est aussi un libéral conscient des limites du système, et il voit dans l’expansion coloniale un levier pour développer l’industrie et renforcer le rayonnement du pays. Héritier de Guizot, il conçoit l’action politique comme un pont entre l’histoire et l’avenir, cherchant à préparer la France à se relever tout en contribuant au progrès mondial.