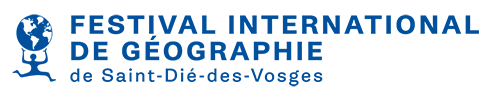La traditionnelle ouverture officielle du Festival International de Géographie s’est tenue ce vendredi 3 octobre à l’Espace Georges-Sadoul. Une cérémonie marquée par la prestation du duo « magique » que composent Victoria Kapps (directrice du Festival) et Thibaut Sardier (président de l’ADFIG), avant le grand entretien avec Valérie Masson-Delmotte, présidente de cette 36e édition.
Le Festival International de Géographie est, par nature, un événement qui allie sérieux et esprit festif. Pour ceux qui en doutaient, l’inauguration de cette nouvelle édition, organisée comme le veut la tradition le vendredi soir dans la salle Yvan-Goll de l’Espace Georges-Sadoul, en a été la parfaite illustration.
Après le mot d’accueil du maire Bruno Toussaint et les nombreuses interventions des représentants politiques, décrivant le FIG sous toutes ses coutures, et l’allocution d’Amaël Cattaruzza, directeur scientifique 2025, Thibaut Sardier et Victoria Kapps ont allié subtilité, justesse et clarté, le tout saupoudré d’une pointe d’humour et de véritables baguettes magiques, pour remercier l’ensemble des acteurs et partenaires qui font (et feront) vivre le festival. « Nous essayons de démocratiser la géographie et les sciences sociales tout en rappelant l’importance des mots, comme celui de la paix », a souligné la directrice du Festival.
En somme, un climat de légèreté insufflé à une discipline pourtant marquée par des tensions croissantes avec le pouvoir politique, un sujet largement abordé lors du grand entretien inaugural avec Valérie Masson-Delmotte, présidente de cette 36e édition. « Les géographes n’ont heureusement pas de pouvoir politique, mais notre pouvoir est de faire rentrer le futur dans le présent », a-t-elle confié, interrogée par le journaliste Mathieu Vidard.
Son domaine, c’est la paléoclimatologie, autrement dit : la science qui étudie les variations météorologiques et les climats passés. Pour elle, « le climat n’est pas stable ni immuable » : il est influencé par l’action humaine, un fait désormais incontestable, établi par de nombreuses études.
Une action humaine qui se concentre principalement dans les pays très développés, dont la France, classée parmi les dix plus gros contributeurs. Pourtant, ce ne sont pas ces pays qui subissent le plus les conséquences. « La moitié de la population mondiale n’a contribué à rien », déplore Valérie Masson-Delmotte. « Cela pose notamment des questions de justice et d’inégalités », poursuit-elle.
Pire encore : le climat serait, selon elle, « un véritable témoin de la désinformation » propagée par certains réseaux sociaux comme X (anciennement Twitter) ou TikTok. Une désinformation que seules de réelles actions politiques en faveur du climat pourraient espérer contrer.
Et pour cela, il faudra sans doute bien plus qu’un simple coup de baguette magique…